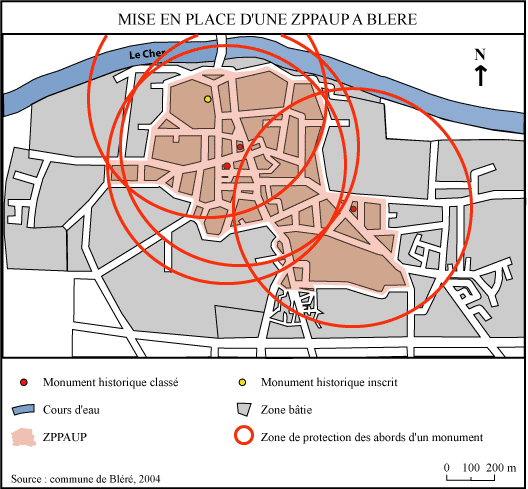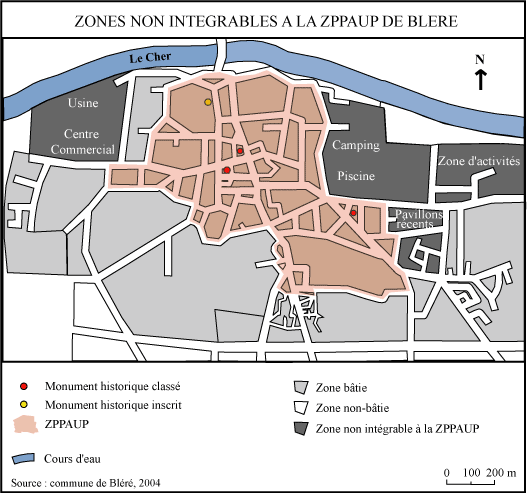| Table
des matières |
||
|
||
| I. Valeurs patrimoniales d'hier et d'aujourd'hui | ||
| II. Des valeurs à protéger | ||
| A. Protéger des édifices | ||
| B. Protéger des espaces | ||
|
||
| B.
Protéger des espaces
1. Mise en place d’une ZPPAUP : l’exemple de Bléré Le recours au classement et à l’inscription permet de protéger efficacement des édifices. Cependant, le patrimoine des communes de la vallée du Cher ne se limite pas à quelques monuments isolés, placés sous la protection de l’État. Les premiers spécialistes du patrimoine, tel Riegl, ne considéraient les monuments que dans leur unité, sans se soucier de leur environnement immédiat. Aujourd’hui, les spécialistes de la question patrimoniale ainsi que de nombreux acteurs envisagent la question différemment. Ils s’intéressent de plus en plus à des quartiers anciens ou des ensembles urbains qui incluent les monuments majeurs (protégés) ainsi que les bâtiments situés dans leur entourage proche. On considère désormais qu’un monument seul n’a pas de sens, c’est son appartenance à un ensemble bâti qui fait sens. Gustavo Giovannoni, spécialiste du patrimoine et inventeur du terme « patrimoine urbain », considère que « le tissu articulé des édifices mineurs constitue le contexte de l’édifice majeur, chacun est solidaire de l’autre, l’un n’a pas de sens historique et esthétique sans l’autre » (Giovannoni 1931 : 20). Il devient donc indispensable de se préoccuper du sort des bâtiments qui composent cet ensemble, tant les actions négatives qui pourraient être menées sur eux seraient susceptibles de nuire directement ou indirectement aux monuments protégés. Mais ce nouveau concept montre aussi une nouvelle manière d’envisager le patrimoine, non plus comme un édifice mais comme un espace. Dans les villes et les villages, on s’attache de moins en moins à mener des actions sur des immeubles isolés car on leur préfère une gestion globale du bourg ancien. Les communes prennent conscience que leur image est véhiculée principalement par le patrimoine bâti du centre ancien et envisagent de plus en plus leurs actions à cette échelle. Depuis une vingtaine d’années, des mesures de protection d’espace viennent les aider dans leur démarche. Ainsi, depuis la loi
de décentralisation du 7 janvier 1983, les communes ont
la possibilité d’établir une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) qui remplace
la zone des 500 m de co-visibilité située autour
d’un monument classé ou inscrit. Elle peut aussi
être instituée dans un quartier ou un site à
protéger, indépendamment de la présence d’un
monument classé.
Figure 9 : Mise en place d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager à Bléré, 2004. Réalisation : Brice Bonaldi. Sur cette carte sont représentées
les zones de protection des abords (rayon de 500 mètres
autour du monument) qui ont été remplacées
par la ZPPAUP. On s’aperçoit que la nouvelle zone
de protection est moins vaste que l’espace occupé
par la protection des abords. La ZPPAUP recouvre tout le centre
ancien ou se situent deux monuments classés et un monument
inscrit, tandis que le troisième monument classé,
le plus à l’est, bénéficie d’une
zone de protection assez restreinte sur ses faces nord et est.
Ceci peut s’expliquer par la présence d’une
piscine municipale et d’un camping dans la zone bâtie
située juste au nord, peu compatibles avec les principes
de protection, et par la présence de pavillons des années
50’ dans la partie est de la commune, qui dénotent
avec le centre ancien. La carte suivante illustre parfaitement
cette volonté de la commune de limiter la protection au
seul patrimoine bâti ancien.
Figure 10 : Les zones non intégrables à la ZPPAUP de Bléré, 2004. Réalisation : Brice Bonaldi. Il ressort sur cette carte que des espaces jugés incompatibles avec les critères de protection ont été volontairement exclus de la ZPPAUP. La commune et l’architecte des bâtiments de France, à travers ce périmètre, ont cherché à concentrer leur politique de protection sur les bâtiments anciens, les usines, les maisons neuves, constructions collectives récentes (piscine, camping) ou encore le centre commercial ne sont donc pas intégrés à la ZPPAUP. Leur présence dans la zone de protection serait à la fois incohérente – la destinée des monuments n’étant pas liée à celles des usines ou du camping – et source de complexité puisqu’il serait difficile de leur appliquer les effets inhérents à l’adoption d’une ZPPAUP.
La protection d’espaces patrimoniaux ne s’arrête pas à la mise en place de ZPPAUP. D’autres mesures, tels le classement et l’inscription sur l’inventaire des sites, permettent une protection efficace d’un ensemble bâti. Dès 1906, qui marque l’adoption de la première loi de protection des sites, la volonté de protéger des espaces bâtis et paysagers s’est manifestée chez les plus hauts responsables de la sauvegarde du patrimoine. Renforcée dès 1930, la législation sur les sites s’applique désormais aux sites naturels dont « la conservation ou la préservation présente au point de vue artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. » (loi du 2 mai 1930). Le terme « site naturel » est employé, pourtant cette loi ne vise pas les sites exclusivement naturels. Il s’agit de protéger un site dans sa globalité, en associant par exemple un monument bâti à son environnement naturel proche. Il faut bien entendu que patrimoine bâti et patrimoine naturel soient liés aussi bien géographiquement qu’historiquement ou esthétiquement. Pareillement à la législation sur les édifices, la loi de 1930 distingue deux degrés de protection : l’inscription et le classement. L’inscription d’un
site sur l’inventaire des sites dépend de la commission
départementale des sites, qui « prend l’initiative
des inscriptions qu’elle juge utiles et donne son avis sur
les propositions d’inscription qui lui sont soumises après
en avoir informé le conseil municipal intéressé
» (Bezançon 1992 : 136), le simple avis de ce dernier
étant nécessaire. Ensuite, si la commune ne donne
pas suite dans les trois mois un arrêté d’inscription
du ministre chargé de la culture est prononcé. Le
préfet se charge de prévenir le propriétaire
du site qui ne peut que constater l’inscription, son consentement
n’étant pas requis. Le propriétaire pourra
toujours entretenir son bien tant qu’il ne s’agit
que de « travaux d’exploitation des fonds ruraux »
(Bezançon 1992 : 136). Pour entreprendre des travaux sur
les bâtiments, il doit en avertir l’administration
(quatre mois à l’avance) qui lui délivrera
un permis de construire contenant un avis simple de l’architecte
des bâtiments de France (la commune peut passer outre l’avis
de l’architecte mais elle engage alors sa responsabilité).
La publicité est interdite dans la périmètre
du site dont la délimitation figure sur le POS (plan d’occupation
des sols) ou sur le PLU (plan local d’urbanisme) si la commune
s’en est doté d’un.
Figure 11 : Inscription sur l’inventaire des sites : l’exemple de Villandry, 2004. Réalisation : Brice Bonaldi.
Si la commune, le commission départementale des sites ou la commission supérieure décident que l’inscription d’un site n’est pas suffisante, elles peuvent recourir au classement. Suite à la demande, le préfet organise une enquête lors de laquelle le bien fondé du classement sera éprouvé. Dès lors que l’arrêté de classement est signé, le public est associé au projet puisque des notices explicatives et un plan de délimitation sont mis à sa disposition, l’idée étant tout autant d’informer que d’éduquer la population. Un délai de vingt jours leur est même accordé afin qu’ils puissent faire part de leurs observations à la commission qui pourra peut-être en tenir compte. C’est pendant cette période que les propriétaires directement concernés par le classement font connaître leur position vis à vis du projet, leurs remarques, si elles sont pertinentes, pouvant entraîner des modifications. Le classement devient effectif après « arrêté ministériel ou pas décret en conseil d’État. Il est notifié aux personnes privées concernées, publié au Journal Officiel et soumis à la publicité foncière » (Bezançon 1992 : 137). Une indemnité est versée aux propriétaires pour qui le classement entraîne un préjudice financier, puisqu’ils doivent se conformer à ses prescriptions. Les effets du classement d’un
site sont beaucoup plus lourds que ceux de l’inscription,
puisque la loi précise que les sites classés «
ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans
leur état sauf par autorisation spéciale du ministre
chargé des sites » (loi du 2 mai 1930). Il s’agit
d’une exigence délicate pour les propriétaires
car leurs actions dépendent directement du ministère
(qui délivre le permis de construire), pouvoir centralisé
dont les préoccupations ne peuvent pas être aussi
locales que les communes ou les architectes des bâtiments
de France. La publicité est interdite, et les propriétaires
de biens situés dans la zone du classement qui souhaitent
les mettre en vente doivent avertir les futurs acquéreurs
de l’existence du « classement de site ». Encore
une fois, le classement entraînant un usage complexe du
site (autorisation ministérielle nécessaire pour
engager des travaux) il peut poser problème aux propriétaires
qui désirent vendre leur bien, le statut de classement
faisant réfléchir l’acheteur potentiel. On
comprend ainsi que les propriétaires de biens situés
sur le site aient eu la possibilité de « faire connaître
au préfet leur accord ou leur opposition au projet »
(Bezançon 1992 : 137) lorsque celui ci était en
cours de réalisation. Même si l’état
consent à donner des subventions pour des « travaux
d’entretien et de mise en valeur » (Bezançon
1992 : 137), les effets du classement sont surtout de nouvelles
contraintes pour les propriétaires : leur bien est difficilement
modifiable, sa revente est rendue plus difficile. Ce manque de
liberté pour les propriétaires est pourtant une
garantie pour l’efficacité de la protection. 3. Inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO : reconnaissance et protection de la vallée du Cher Nous allons à présent évoquer ce qui constitue peut-être l’aboutissement ultime des mesures de protection : l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Appartenir à cette prestigieuse liste signifie pour un site que toutes les mesures de protection de son patrimoine (bâti ou naturel) lui ont permis de maintenir ses atouts dans un état respectable et de les pérenniser. L’inscription se déroule d’un manière assez simple. Tous les états ayant ratifié la convention du patrimoine mondial ont la possibilité de proposer des sites de leur territoire. L’impulsion peut être aussi bien le fait de l’état lui même que d’une collectivité locale ou d’un personne privée. Un dossier complet détaillant le projet d’inscription, avec notamment une explication poussée de la délimitation du site proposé, doit être soumis au comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui demande conseil à l’association ICOMOS (International Council on Monuments and Site – Conseil International des Monuments et des Sites) avant d’inscrire le nouveau site. Le comité vérifie l’état de conservation du site ainsi que les mesures prises par les autorités pour le protéger. Il peut accorder des subventions émanant du Fond du patrimoine mondial si une restauration est indispensable. Il est permis de demander l’inscription de trois types de biens culturels : les monuments, des ensembles (groupes de construction isolés ou réunis) et des sites (œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature). Ces étapes furent franchies
avec succès par les responsables de l’inscription
du « Val de Loire », le parc naturel régional
« Loire-Anjou-Touraine », puisque le site est inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le
2 décembre 2000. La délimitation du site fût
une étape essentielle pour l’obtention du précieux
label, un essai infructueux en 1999 ayant déjà eu
pour origine un tracé, incluant des centrales nucléaires,
critiqué par le comité du patrimoine mondial. À
ce sujet, La Nouvelle République datée du 3 décembre
1999 annonçait que « quand le dossier Loire est venu
sur la table, les représentants de l'Australie, de la Grèce
et de la Finlande sont montés au créneau, car ils
n'avaient pas d'atomes crochus avec ces centrales ». La
nouvelle délimitation proposée en 2000 excluait
alors les zones responsables de l’échec, notamment
la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le
Loir-et-Cher. Mais elle incluait toujours une partie relativement
importante de la vallée du Cher, puisqu’environ la
moitié (en longueur) de la partie du Cher située
en Indre-et-Loire en faisait partie. Les responsables du dossier
d’inscription ne se satisfaisaient pas de la seule vallée
de la Loire, la vallée du Cher (et la vallée de
l’Indre) regorgeant aussi d’un riche patrimoine dont
l’intégration dans le site ne pouvait être
que bénéfique. C’est ainsi qu’une partie
des territoires de Villandry, Savonnières, Saint-Genouph,
Ballan-Miré, Saint-Avertin et Veretz appartiennent désormais
au prestigieux site du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial.
Fortes de 17 châteaux et 13 manoirs, dont un château
de grande renommée (Villandry), ces communes relativement
proches de la Loire sont parfaitement à leur place aux
cotés des autres communes du site.
Figure 12 : Inscription du Val de Loire au Patrimoine mondial de l’humanité : la place de la vallée du Cher, 2004. Réalisation : Brice Bonaldi. Pour les communes de la vallée
du Cher, l’intégration à cet espace reconnu
par l’UNESCO doit être perçue autant comme
une chance que comme une obligation de préserver d’avantage
encore le patrimoine bâti (et naturel). En effet, parmi
les quatre critères retenus par le comité pour définir
le caractère exceptionnel du Val de Loire figure celui-ci
: L’État français
est garant de la pérennité du site, mais pour conserver
toutes les qualités de cet espace et le valoriser il doit
faire appel aux différents acteurs locaux. Ceux-ci sont
bien conscients de leur mission et ont tous un avis sur la question
de l’inscription, qu’ils soient élus d’un
commune incluse dans le site, d’un commune non incluse ou
membres d’association.
|